
L’expression peuple sahraoui désigne généralement
l’ensemble des personnes vivant au Sahara occidental. Cependant, elle
est parfois contestée dans cette acception et est aussi utilisée pour
désigner l’ensemble des peuples vivant dans le désert saharien.
Émancipées, les Sahraouies le sont depuis
des lustres. Héritières d’une société matriarcale, elles ont su
conserver leurs droits bien avant la nouvelle Moudawana (droit de la
famille marocain codifié en 1958). Visite guidée dans un univers
profondément ancré dans le féminisme.
Ce que femme veut, Dieu le veut
« Si ta femme te dit de te jeter dans un puits, espère seulement qu’il n’est pas profond » énonce le dicton sahraoui, soulignant derechef le rôle primordial et partant, original de la femme dans ces sociétés nomades.
Certes, n’idéalisons pas ! Il existe chez les Sahraouis une image
première des femmes qui est semblable à l’opinion dominante dans la
plupart des cultures du monde, l’idée qu’elles sont physiquement moins
fortes que les hommes. A la différence fondamentale « qu’argument
est tiré de cette faiblesse pour justifier tous les moyens et les
institutions capables d’assurer le pouvoir économique et social des
femmes » explique l’ethnologue Hélène Claudot-Hawad.
Ce que confirme Elazza Likhili, de l’Union Nationale des Femmes Marocaines (UNFM) section Laayoune,
« la femme sahraouie a toujours eu un rôle dans notre société et dans
nos familles. Elle joue le rôle de l’homme dans une société nomade ». La même souligne, « qu’historiquement,
la seule activité était le commerce, via les caravanes. Or, il fallait
trois mois pour rejoindre Goulmime qui était le premier point
commercial. Du coup, il incombait à la femme la gestion des biens et de
la tente. C’est ce qui a donné sa force et son indépendance à la femme
sahraouie ».
Ce raisonnement conduit à une représentation donnant au pôle féminin
une nécessité vitale, image pour le moins marginale dans la pensée du
monde méditerranéen. « La femme représente le chaînon stable et
permanent de la communauté, le point fixe autour duquel évolue et
s’agite le reste du monde » précise encore Hélène Claudot-Hawad.
Le Maroc, matriarcal jusqu’au 17ème siècle
Pour Batoul Daoudi, de la tribu des Aït Lahcen et responsable de
l’Agence de développement social des provinces du sud, il faut remonter
dans le temps pour comprendre cet état de fait. « N’oublions pas que jusqu’à l’arrivée des Beni Hassan au 17ème, venant d’Arabie, les tribus sahraouies, essentiellement senhaja, étaient régies selon le modèle matriarcal.
Ce n’est qu’avec les Beni Hassan que les tribus basculeront peu à peu
vers le modèle patriarcal, tout en gardant des caractéristiques
senhajas, notamment en ce qui concerne le rôle des femmes ». Ainsi,
même si la législation islamique a gagné du terrain et se trouve
adoptée partout, la construction du monde autour du principe féminin
résiste encore sur le plan idéologique.
Pour preuve, Salka Benabda, de l’association Basmat Al Amal, section Laayoune précise que « depuis
sa naissance, la fille sahraouie est sacrée, elle est placée au centre
de l’attention familiale. D’ailleurs, insiste-t-elle, les tribus les
mieux cotées sont celles qui prennent soin de leurs filles ».
Ainsi, toutes sont unanimes pour dire que de l’enfance à l’adolescence,
la fille sahraouie est choyée et qu’une fois devenue femme, son avis est
primordial. Elle est d’ailleurs consultée pour toutes les affaires du
foyer comme de la tribu. Ce que relève une fois encore notre ethnologue,
« dans les assises ou les conseils, qui réunissent hommes et femmes
d’une même lignée, la voix féminine pèse autant et même davantage que
celles des hommes. Une décision ne peut être arrêtée que si les femmes
sont d’accord ».
Autant dire que la femme sahraouie jouit d’un respect, tant familial
que tribal, que peuvent lui envier bien des femmes du « dakhil ». C’est,
à n’en pas douter, ce qui explique l’absence quasi-totale du phénomène
de la violence conjugale chez les Sahraouis, « les relations de
mariage empêchent les relations guerrières entre tribus, d’où le respect
envers la femme, car la violenter, reviendrait à infliger cette
violence à toute la tribu » détaille Batoul Daoudi.
Le divorce, fête de la liberté des femmes
Et a contrario, c’est aussi ce qui justifie le taux si élevé de divorces dans la région. La même souligne, « la femme sahraouie quitte le foyer à la moindre injure qui touche sa dignité ou en cas d’adultère ». Loin de lui valoir l’infamie, le divorce est souvent l’occasion de faire la fête. « On signifie à l’ex-mari que ce n’est pas la fin du monde, que la vie de son ex-femme vient à peine de recommencer » explique Batoul. Pour l’anthropologue Mohamed Naïmi, cette fête symbolise également l’acquisition d’une entière liberté,
« quand elle se marie, la femme passe de la tutelle du père à celle de
son mari. Une fois divorcée, elle devient libre. C’est précisément ce
que l’on célèbre ».
Quand le droit tribal prime sur le droit d’Etat
Du coup, nos trois amies sourient franchement quand on leur parle de
la réforme de la Moudawana, visant à rendre effective l’égalité entres
sexes, énoncée dans la constitution. « Dans notre société, la Moudawana n’a jamais été appliquée, ce sont les lois tribales qui prévalent »
précise d’emblée Elazza Likhili. C’est sans doute ce qui explique que
les concepteurs du nouveau texte se sont largement inspirés des
propositions formulées par la section de l’UNFM des provinces du sud.
C’est la femme qui prend époux
A titre d’exemple, depuis toujours, la femme sahraouie est consultée
pour son mariage, c’est elle qui « prend époux ». L’expression est
d’autant plus explicite qu’il existe, selon l’anthropologue Mohamed
Naïmi, des « tribus donatrices » de femmes. Ce qui signifie, non pas que
l’on « donne » une femme à la tribu du mari mais qu’au contraire, le
mariage permet de « prendre » l’homme à la tribu en question, renforçant
ainsi le poids de celle dont est issue la future mariée. Pour Naïmi,
les « tribus donatrices » sont celles qui dominent économiquement. Plus
intimement, la tradition veut que les deux époux se vouent une vie de
respect ou une séparation à l’amiable.
Pas de communauté de biens dans le mariage
D’ailleurs, en cas de divorce, la femme emporte tout : tant les biens
légués par son père au moment du mariage (c’est lui qui achète tout
pour que sa progéniture n’ait rien à devoir à son époux) que ceux que
lui aura achetés son mari pendant l’union. La tradition veut que l’homme
ajoute encore des biens pour garder de bonnes relations avec la famille
de son ex-femme.
Le divorce, une simple formalité tribale
Du coup, il est aisé de concevoir que le divorce, véritable chemin de
croix des Marocaines du Dakhil, n’a jamais été vécu comme tel par nos
sahraouies. D’autant qu’au sud, le moment pénible passé devant les
tribunaux de famille ne représente qu’une simple formalité. « Les
problèmes se règlent au sein de la tribu. Nous allons au tribunal juste
pour le tampon. Il est honteux pour un homme de pousser sa femme à se
présenter devant un juge pour réclamer ses droits ou ceux de ses
enfants. Ces derniers sont d’ailleurs automatiquement pris en charge par
la famille » ajoute B. Daoudi.
Pas de polygamie
Et la polygamie dans tout ça ? Un extra-terrestre. Le contrat de
mariage des Sahraouies comprend depuis des décennies une clause
stipulant que « la sabiqa wa la lahiqa, wa ida tamma dalika fa amrouha biyadiha », ce qui signifie approximativement, « ni précédente, ni suivante et si cela se passe, c’est à la femme de décider de son sort ». Voilà qui est clair.
Bouleversés par l’administration sédentaire
Lumineuse également, la conclusion de Mohamed Naïmi précisant que « les
tribus sahraouies ont connu un bouleversement radical avec l’arrivée de
l’administration marocaine et la sédentarisation forcée. Reste que la
dimension nomade est enracinée… et non l’inverse ». Un enracinement
tel, qu’il a permis le maintien d’une indéniable construction
symbolique, centrée autour de la femme, pilier de la famille, de la
tente, de la tribu, de l’univers.

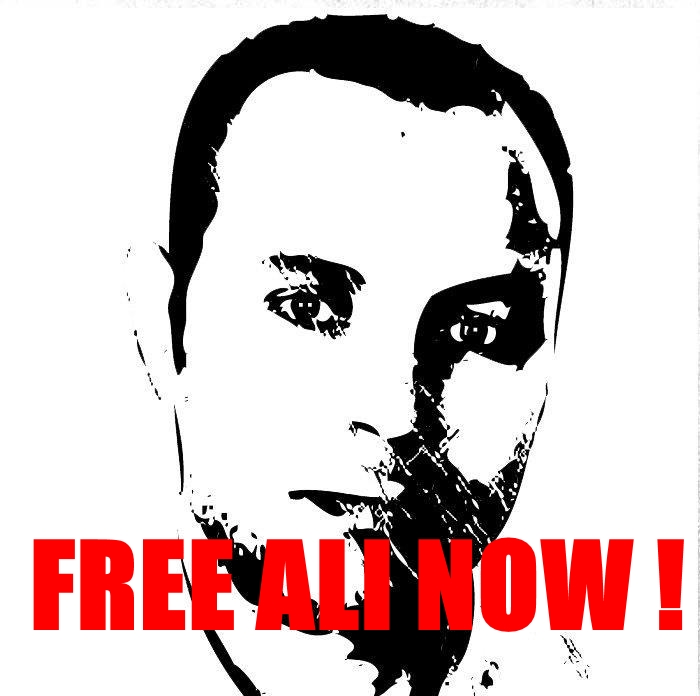



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire